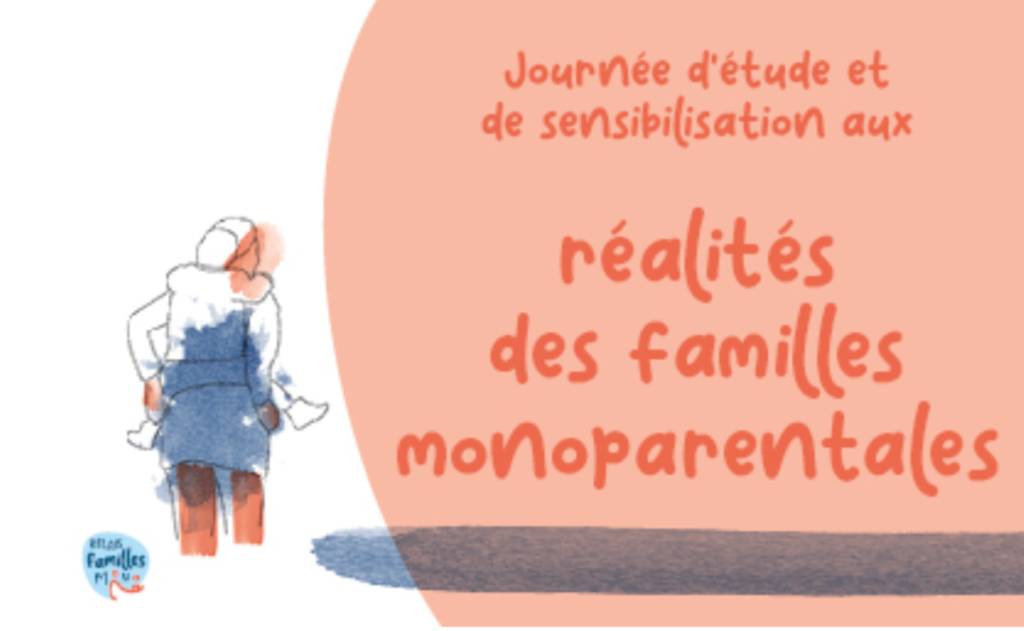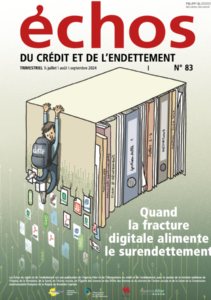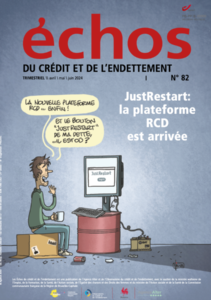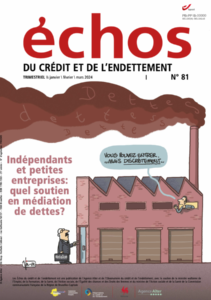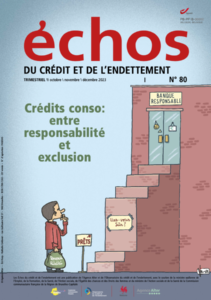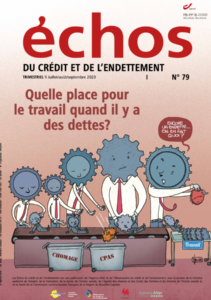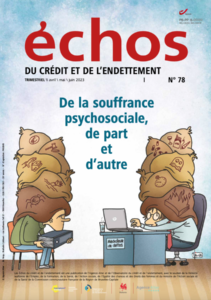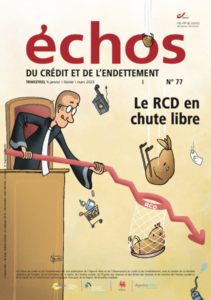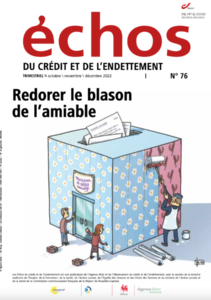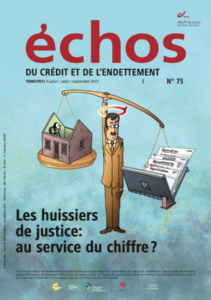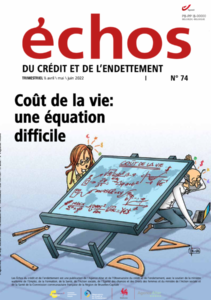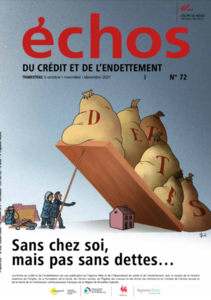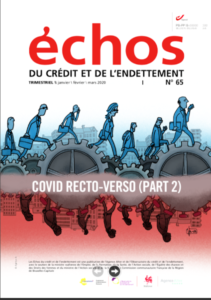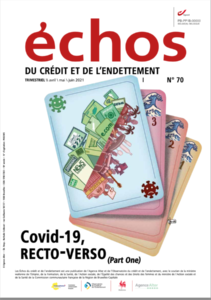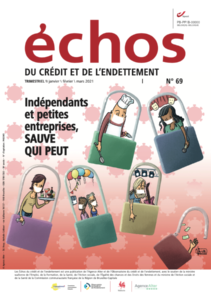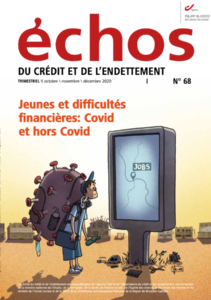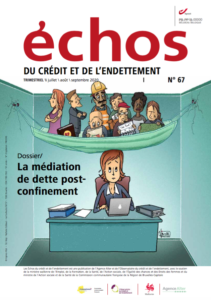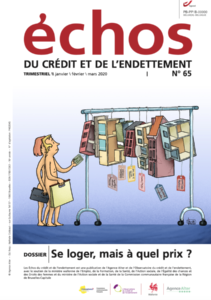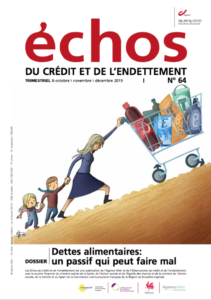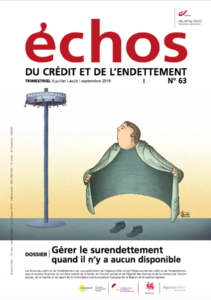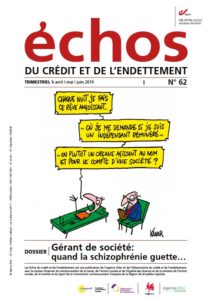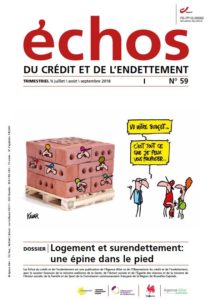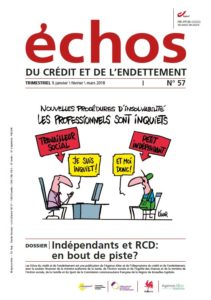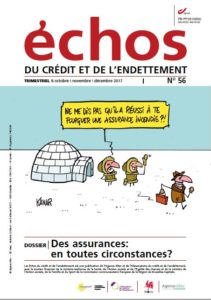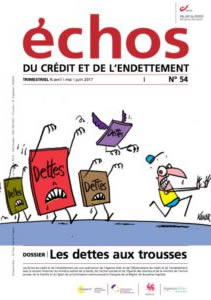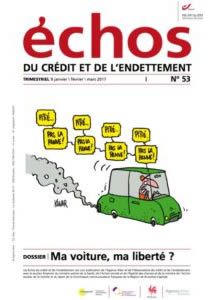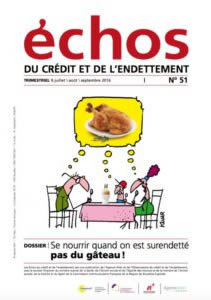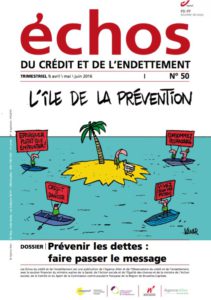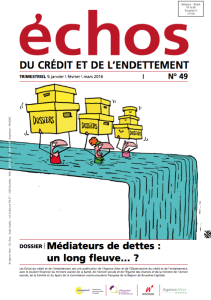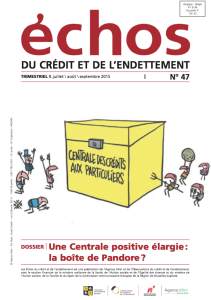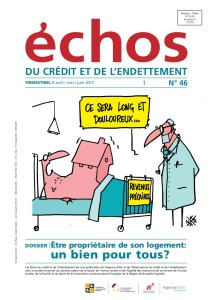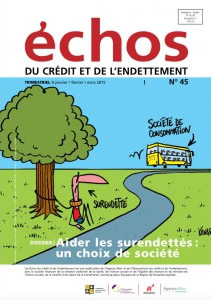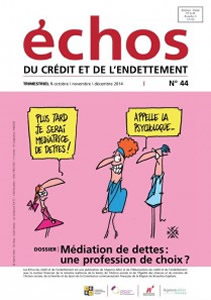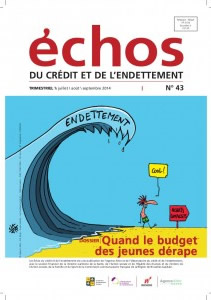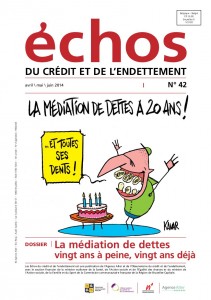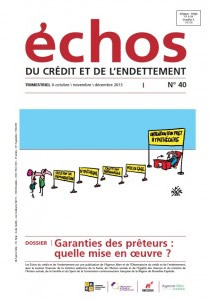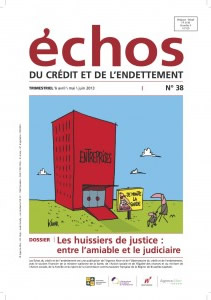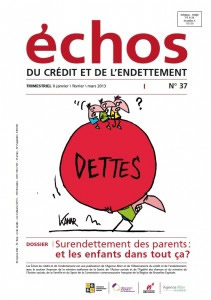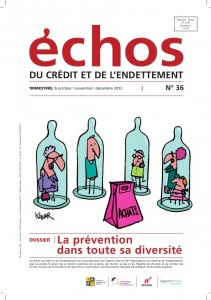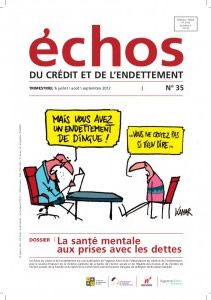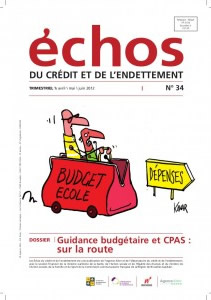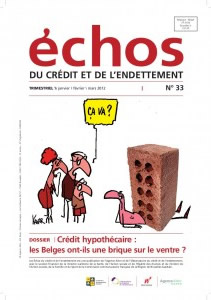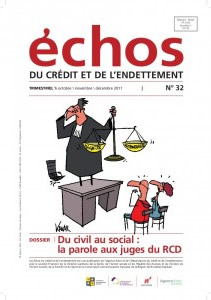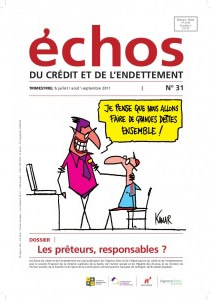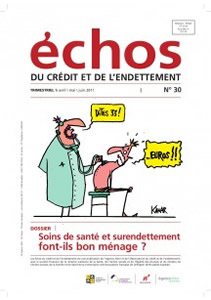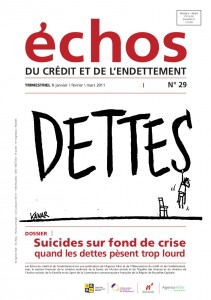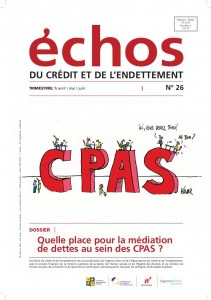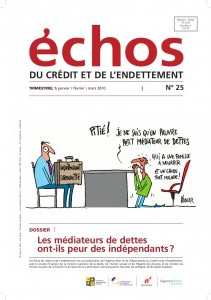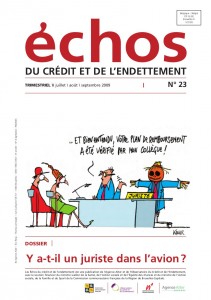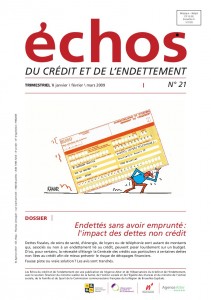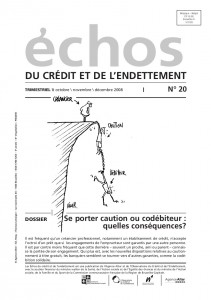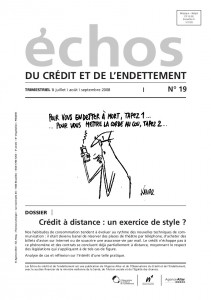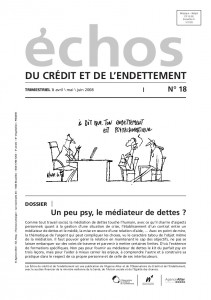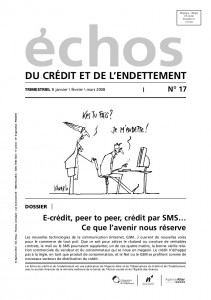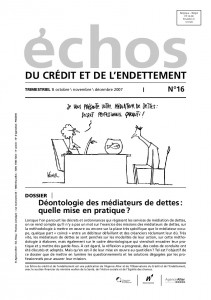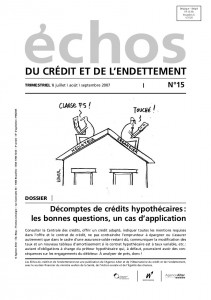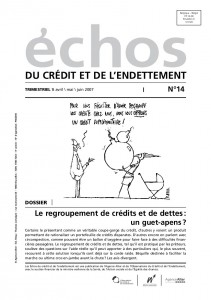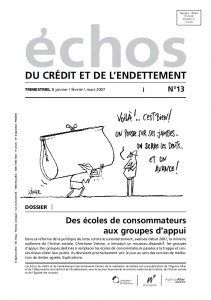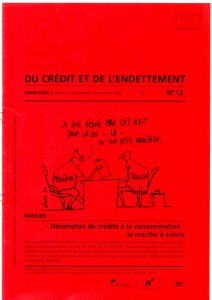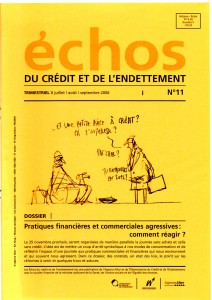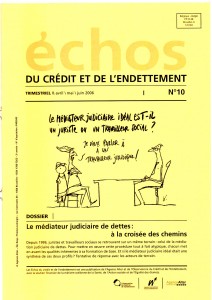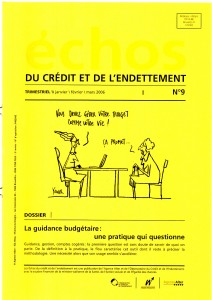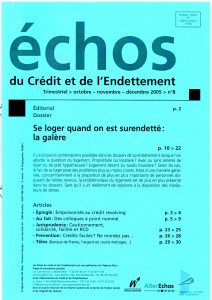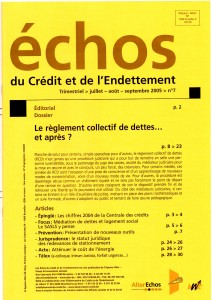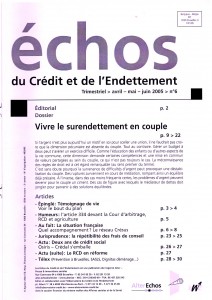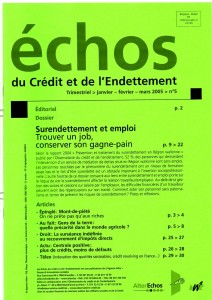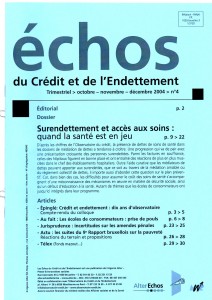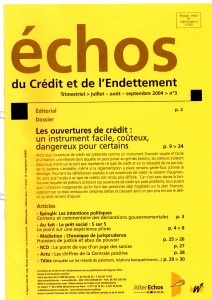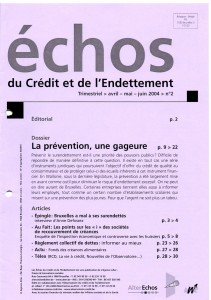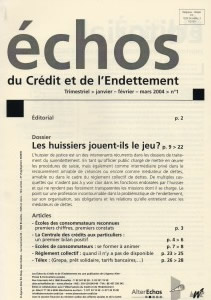Dans le cadre du dispositif «Relais Familles Mono»[1] qui aide et accompagne les familles monoparentales en Wallonie, la Fédération des services sociaux a organisé une journée d’étude et de sensibilisation aux réalités de cette situation en décembre dernier. Particulièrement exposées aux risques d’exclusion sociale et financière[2], les familles monoparentales requièrent une attention particulière et l’élaboration de mécanismes supplémentaires afin de les protéger efficacement face aux défis qu’elles rencontrent[3]. Parmi les instruments envisagés pour tenter de remédier à ce problème figure l’éventuelle création d’un statut de «famille monoparentale».
Déjà présente dans l’agenda politique, la réflexion sur la création d’un statut spécifique pour les familles monoparentales a été abordée lors d’un atelier de la journée d’étude de la FDSS du 17 décembre dernier. Celui-ci a permis de mettre en lumière certaines interrogations et craintes concernant l’élaboration d’un tel statut. Les discussions n’étaient pas animées par une volonté d’encourager ou de décourager la création de ce statut spécifique, mais plutôt de susciter les échanges et de mettre à nu certains impacts négatifs potentiels. La mise en place d’un statut et l’élaboration de ses conditions d’accès demandent nuances et précautions.
Les écueils identifiés et les points d’attention à retenir dans ce texte sont issus des constats et des observations tirés de cet atelier.
Quelle définition de la famille monoparentale?
Pour parler d’un statut de «famille monoparentale», il faut tout d’abord s’accorder sur la définition de l’objet que ce statut entendrait protéger. La Ligue des familles a défini comme parents monoparentaux «tous ceux et celles qui, à un moment de leur vie, se retrouvent en situation d’assumer seul(e)s de manière permanente, principale, égalitaire ou occasionnelle, l’hébergement et l’éducation d’un enfant»[4]. Le public invité aux activités organisées via le projet Relais Familles Mono se calque d’ailleurs sur cette caractérisation.
Dans la législation, on trouve toutefois pléthore de définitions différentes de la monoparentalité et celles-ci peuvent avoir un champ d’application bien plus restrictif. Cette multiplicité est regrettable et fragilise davantage l’accès aux droits des familles monoparentales. Plusieurs facteurs sont parfois considérés pour qu’une famille puisse entrer dans la terminologie de famille monoparentale. Ainsi, il est parfois nécessaire que l’enfant soit domicilié chez le parent alors que, dans d’autres cas, la simple résidence suffit. Dans d’autres situations, il est requis que le parent détienne la garde exclusive de son enfant alors qu’une garde alternée suffit pour d’autres droits. Ou encore, il peut aussi être exigé que le parent ne vive pas avec une autre personne pour qu’il puisse être considéré comme membre d’une famille monoparentale.
La question de la définition interpelle déjà et constitue un défi majeur. Au regard des diverses subtilités déjà utilisées dans la loi pour encadrer le vocable de monoparentalité, il paraît évident que déterminer l’étendue du champ d’application du statut ne sera pas aisé. Or la définition retenue constituera la première condition d’accès au statut, qui pourrait aussi inclure d’autres critères. L’on pense notamment au respect d’un critère financier pour viser un type de famille monoparentale en particulier: la famille monoparentale aux revenus modestes, voire précaires. Ces questions relevant du choix politique doivent néanmoins être mises sur la table et interpeller l’opportunité du statut au regard de l’objectif poursuivi par la création d’un statut distinctif.
Par ailleurs, la question des délais importe également. Quand le respect des conditions sera-t-il analysé? Une fois les conditions remplies, sera-t-il permis au parent de bénéficier du statut jusqu’à la majorité de son enfant? Jusqu’à la fin de l’octroi des allocations familiales? Jusqu’à ce que la situation du ménage se modifie? Dans ce dernier cas, l’on pourrait craindre pour l’individualisation des droits. En effet, que se passerait-il si un parent bénéficiant du statut se remettait en ménage avec une autre personne? Le statut serait-il perdu? Devrait-on considérer que le nouveau membre du ménage fait perdre des droits aux personnes qu’il rejoint? Les questions sont délicates et doivent faire débat.
Les droits associés au statut
Outre ce cadre, le statut requiert aussi d’établir ce à quoi il permettrait de bénéficier. Cela reste rare, mais cela existe: l’accès à certains droits sociaux est déjà facilité pour des situations assimilables à la monoparentalité. En effet, parfois la loi vise à simplifier l’accès à un droit pour une famille monoparentale et crée des conditions en ce sens[5]. Le statut visera-t-il à harmoniser les multiples définitions existantes pour garantir des droits équivalents aux ménages comparables? Vu l’architecture des compétences en Belgique, cela paraît improbable. Il serait nécessaire pour cela qu’agissent de concert l’État fédéral ainsi que les entités fédérées, voire éventuellement des entités supranationales.
Le statut ouvrira-t-il alors à d’autres avantages sociaux? D’autres droits? Ou se cantonnera-t-il à permettre l’accès à des avantages matériels, à la manière d’une carte famille nombreuse ou des tickets article 27? Enfin, ce statut aura-t-il aussi un impact sur les autres aides sociales auxquelles la famille pourrait prétendre?
Il faudra aussi régler le sort de la répartition des avantages si deux parents pouvaient concomitamment bénéficier du statut. Cela pourrait par exemple concerner deux parents séparés partageant la garde de leurs enfants en commun de manière égalitaire. Si l’on considère que ce type de ménage doit se voir octroyer le statut (le ou les enfants seraient alors domiciliés chez l’un des parents et résidents chez l’autre), les avantages en découlant seraient-ils divisés entre les parents? Seraient-ils entièrement acquis par les deux ménages? Ici aussi, la distribution de l’attribution des avantages doit être mise en question. Cela pourrait aussi entraîner de nouveaux enjeux en matière de droit familial en cas de séparation. Les avantages pourraient alors être potentiellement pris en compte lors du calcul des contributions alimentaires à payer par l’un des parents, voire aussi favoriser des conflits autour de la garde des enfants.
Preuve et pratique
Enfin, l’application pratique et administrative doit aussi faire l’objet de réflexions. Quel type de preuves sera accepté pour justifier le respect des conditions? La question se pose en particulier pour les séparations effectuées à l’amiable, qui se déroulent sans avoir recours à des procédures que l’on pourrait qualifier d’«officielles». Le type de preuves acceptées pourrait potentiellement inciter à passer obligatoirement par une procédure en justice, devant notaire ou par le biais d’un médiateur agréé, afin de disposer de documents acceptés par les autorités administratives qui délivreraient ce statut.
Notons qu’il est permis à un parent d’inscrire dans les registres de la population son ou ses enfants qui seraient domiciliés chez un autre parent[6]. Le parent est alors reconnu comme «parent hébergeur». Or, cette notion n’a que très peu d’impact et il est constaté qu’il existe parfois des difficultés pratiques à réaliser cette formalité. D’autres mécanismes sont également imaginés[7]. Ces questions pragmatiques auront un impact non négligeable sur la portée du statut et sur l’évaluation de l’accomplissement des objectifs.
En définitive, parler d’un statut de famille monoparentale à l’heure actuelle reste flou, tant des options différentes sont en jeu et pourraient être choisies selon la ligne idéologique qui sera adoptée. De nombreuses questions et arbitrages politiques restent à trancher pour déterminer les contours d’un éventuel statut de la famille monoparentale.
Romain Knapen, juriste à la FDSS
[1] https://www.fdss.be/fr/hors-les-murs/relais-familles-mono/
[2] Voir notamment: https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/les-familles-monoparentales-les-chomeurs-et-les-locataires-sont-les-plus-vulnerables-la
[3] Logement, privation matérielle, accès à l’emploi, santé psychique… À ce sujet, la FdSS a publié un rapport de recherche «Être femme, précaire et parent solo en Wallonie: Récits de mamans solos, analyses et recommandations», disponible sur: https://www.fdss.be/wp-content/uploads/2024_CRAC_PUB_rapport-cafm_176x250_V07.pdf
[4] Simon N., «Recherche-action sur les besoins et les attentes des familles monoparentales», septembre 2018, disponible sur: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://liguedesfamilles.be/storage/18761/recherche-action-sur-les-attentes-et-les-besoins-des-familles-monoparentales.pdf&ved=2ahUKEwiy6_6Xof-LAxVQ_7sIHfQjM4EQFnoECCAQAQ&usg=AOvVaw2Z3wBpxPHfNoNGl0JK4jRp
[5] Pour le statut BIM: article 18, 8° de l’arrêté royal du 15/01/2014 relatif à l’intervention majorée de l’assurance visée à l’article 37, § 19, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
[6] Article 1er, 31 et 32° de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.
[7] À ce sujet, la Ligue des familles a développé le concept de registre des gardes, ou des modalités d’hébergement: https://liguedesfamilles.be/article/familles-monoparentales-invisibles.
«Cordons» ou une expo sur la précarité des mamans solos
«Cordons» est une exposition qui, sous la forme d’un reportage, va à la rencontre d’une multitude de mamans solos vivant durement la monoparentalité en Belgique francophone. Celles-ci ont été rencontrées chez elles, dans des maisons d’accueil ou au travers de projets collectifs qui leur sont proposés.
Le photographe Christophe Smets est un habitué des thèmes touchant à la précarité, la santé, les droits humains. Depuis 30 ans, il parcourt le monde pour documenter, communiquer, sensibiliser sur le sort des plus démunis, avec une attention plus particulière pour la situation des femmes. En filigrane de ses reportages, Christophe Smets se fait le porte-voix d’Amira, une petite fille rencontrée au début de sa carrière dans les bidonvilles du Caire. Délaissée par ses parents dès la naissance, Amira n’a connu qu’un combat pour la vie.
«Cordons» interroge ce qu’est la monoparentalité et la précarité aujourd’hui. Quelles en sont les formes, les causes et les conséquences? Comment et pourquoi les femmes se retrouvent-elles majoritairement en première ligne de la précarité? Le nom «Cordons» fait référence au cordon ombilical, ce lien qui unit une mère à son enfant, mais aussi aux cordons de la bourse, et le difficile exercice d’équilibre financier quand les difficultés de vie s’accumulent. Autant de rôles essentiels que les mères en situation de monoparentalité précaire doivent assumer.
Les photographies sont accompagnées de textes de Camille Wernaers, journaliste engagée et féministe.
Pour briser l’indifférence
Le photographe est parti à la rencontre de ces mamans solos, dans leur quotidien à la maison. Il les a aussi rencontrées dans des associations, dans des CPAS, notamment dans le cadre du projet MIRIAM, un programme fédéral qui vise à renforcer les participantes de manière à leur permettre de prendre (ou reprendre) leur vie en main, améliorer leur estime et renforcer leur position sociale. Il les a rencontrées à la ville, mais aussi en région rurale, car, selon le lieu de vie, les difficultés sont différentes. Il les a rencontrées dans les maisons d’accueil, victimes de violences conjugales, parfois avec le triste constat que le schéma se répète de génération en génération. Il les a observées, lors de la distribution de colis alimentaires ou lors de la prise en charge d’enfants sévèrement handicapés. Il a rencontré les mamans d’ici, mais aussi les mamans venues de loin, ces mamans de passage hébergées en centre Fedasil.
Pour Christophe Smets, un fossé abyssal sépare le monde de ceux qui vivent la précarité et le monde de ceux qui décident de la politique. Il en veut comme preuve supplémentaire la récente déclaration de politique générale qui n’aborde même pas le sujet des plus vulnérables, indécent selon lui. Il n’a de cesse de dénoncer la précarité et il voudrait afficher ses photos sur les murs des villes pour briser l’indifférence.
L’exposition s’est tenue à la Cité Miroir à Liège du 15/2 au 9/3/2025, elle aura lieu prochainement à Marche-en-Famenne et pourquoi pas dans votre association, l’exposition ayant vocation à être itinérante.
Marie-Christine Calmant
Ce projet photographique de La Boîte à Images asbl (réalisation Christophe Smets, avec des textes de Camille Wernaers) a été mené en partenariat avec la Fédération des services sociaux, le Relais Familles Mono, l’asbl Article 27 et le Réseau des centres d’action laïque.
Pour plus d’infos: http://www.laboiteaimages.eu/