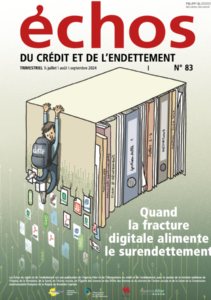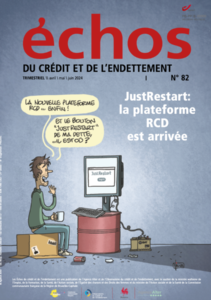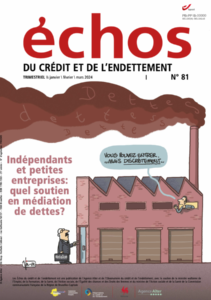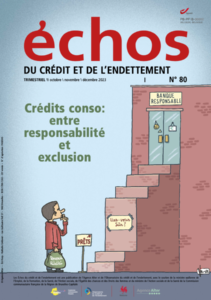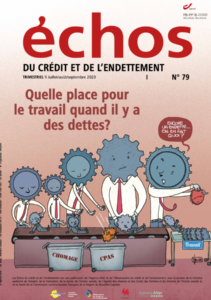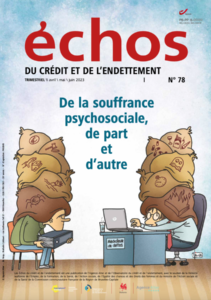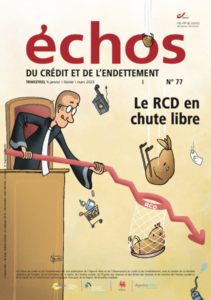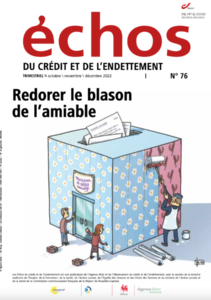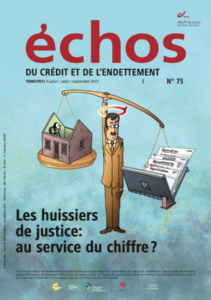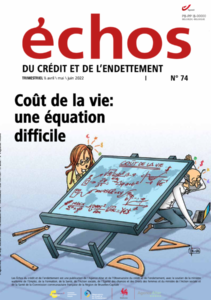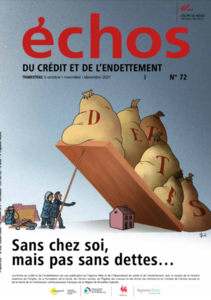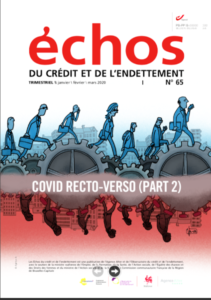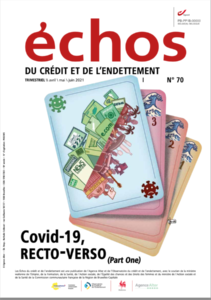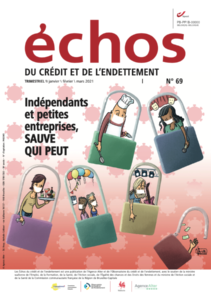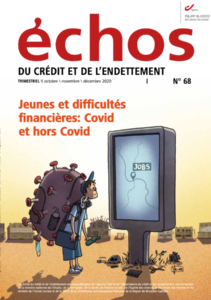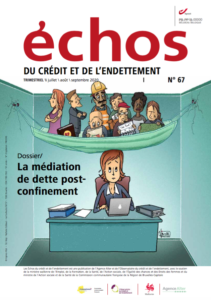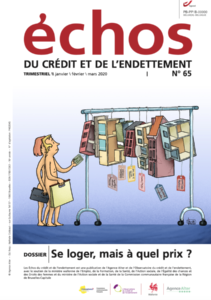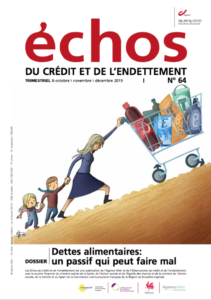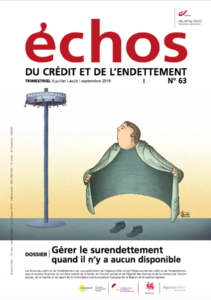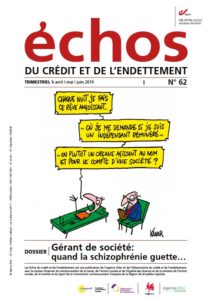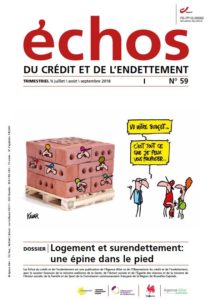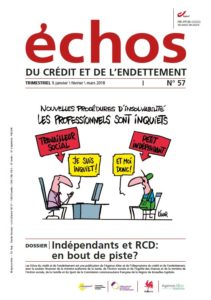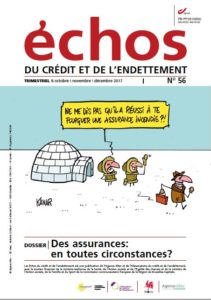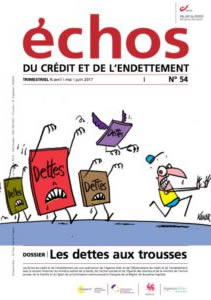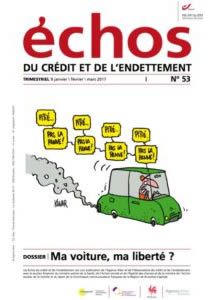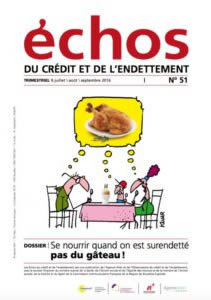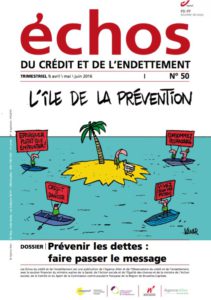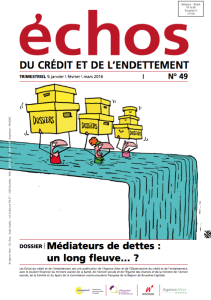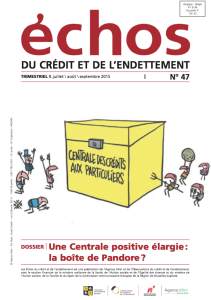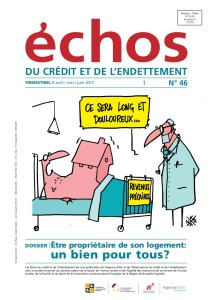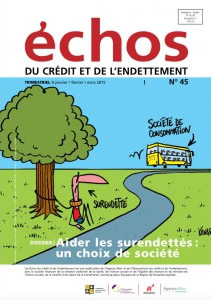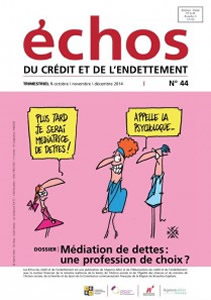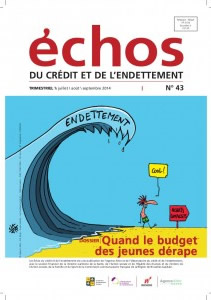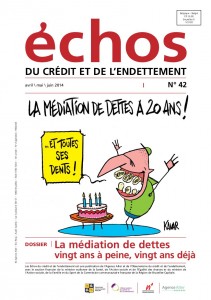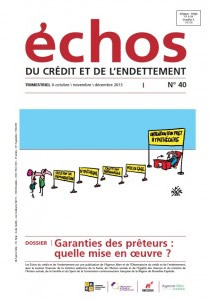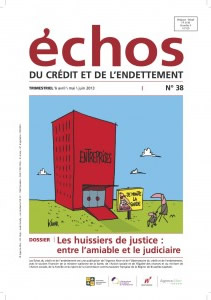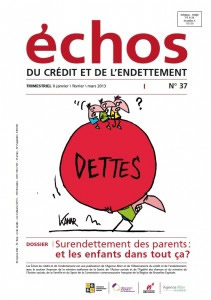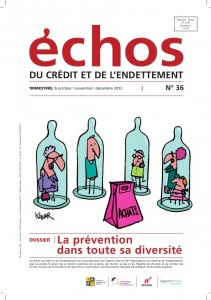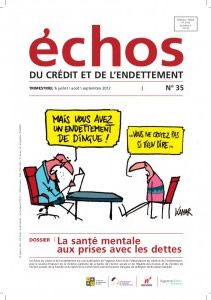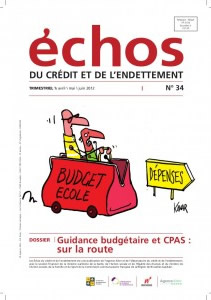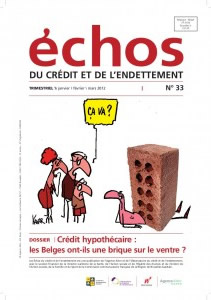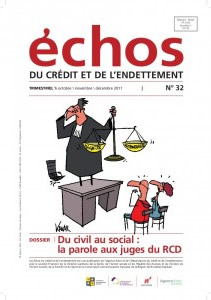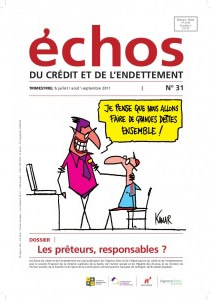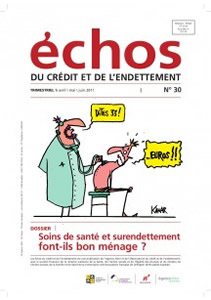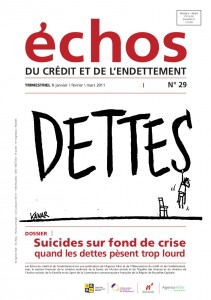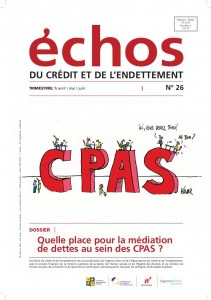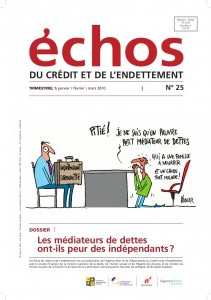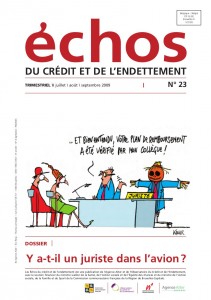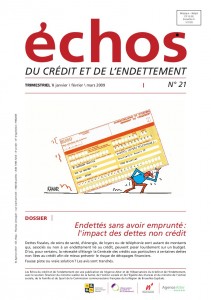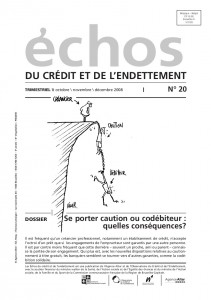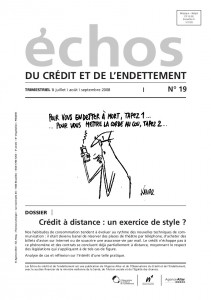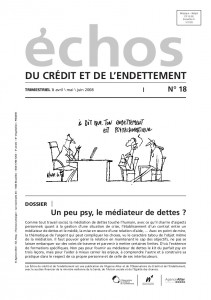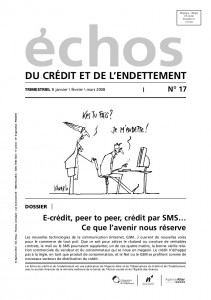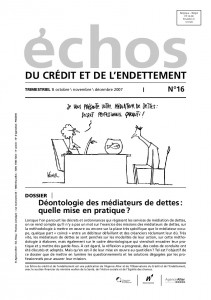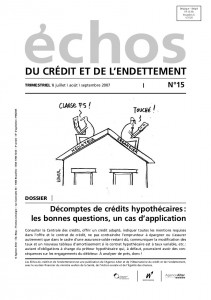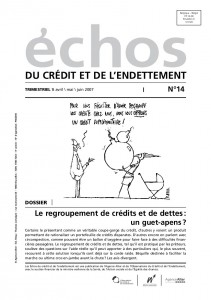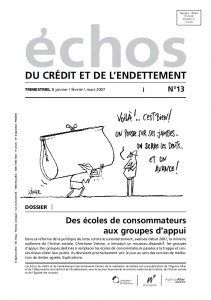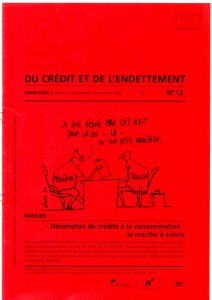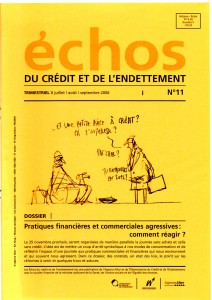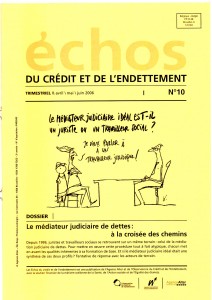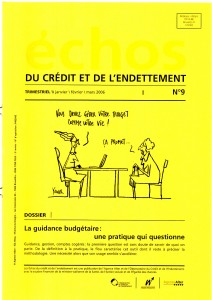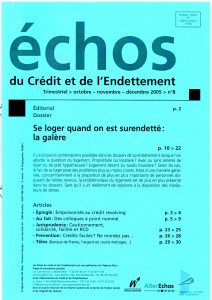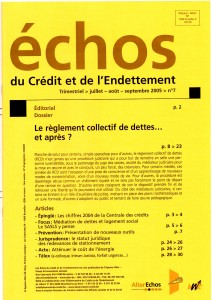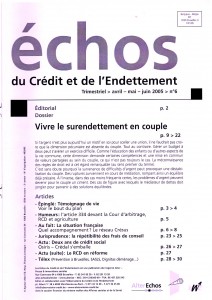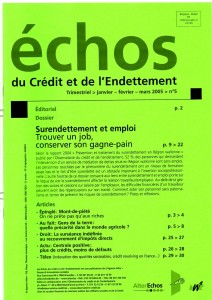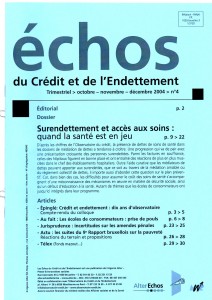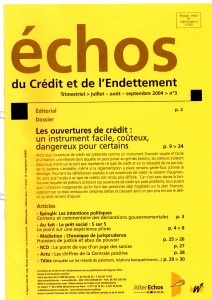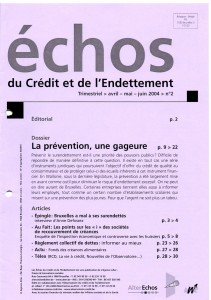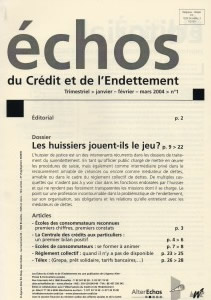RCD
Attention, jurisprudence fraîche!
Dans cette rubrique, vous trouverez une nouvelle livraison de décisions de justice ayant trait au règlement collectif de dettes (RCD), que nous avons sélectionnées afin d’éclairer les dernières tendances jurisprudentielles. Ces décisions ont été rassemblées avec le concours des greffes et de différents relais, comme les syndics de médiateurs de dettes. En voici la recension.
Tribunal du travail de Liège, division Dinant, 9e chambre, 19 décembre 2024 (RG 2021/00086/B)
Plan amiable – Difficultés – Article 1675/7, §1er CJ – Suspension du cours des intérêts – Non – Article 1675/13, §3 CJ – Indemnités pour préjudice corporel causé par une infraction – Dette incompressible – Remise de dettes sur intérêts et frais – Non.
Le 22 juin 2021, le requérant a été admis en règlement collectif de dettes. Parmi ses dettes est reprise une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.000 € accordée pour la réparation d’un préjudice corporel lié à une infraction envers Monsieur B.
Le 15 mars 2024, le tribunal correctionnel a fixé le préjudice de Monsieur B à la somme de 6.919,34 € en principal. Le médiateur a invité ce créancier à lui transmettre sa déclaration de créance définitive, intérêts compris jusqu’au 22 juin 2021, soit à la date de l’admissibilité.
Pour rappel, deux principes sont applicables en l’espèce:
- La décision d’admissibilité a pour effet de suspendre le cours des intérêts[1];
- Certaines dettes ne peuvent pas faire l’objet d’une remise dans le cadre d’un RCD parmi lesquelles se trouvent les indemnités pour réparation d’un préjudice corporel lié à une infraction[2].
Cependant, Monsieur B estimait, vu le caractère incompressible de sa créance, que l’intégralité de celle-ci lui était due et que les intérêts ont continué à courir pendant la procédure. Le médiateur a demandé au tribunal une fixation du dossier pour difficultés.
Le tribunal souligne que la doctrine est partagée sur la question de l’assiette à prendre en compte:
- Une partie de la doctrine[3] considère «que le juge a toujours la faculté de remettre totalement ou en partie les intérêts moratoires, les indemnités et/ou l’accessoire d’une dette alimentaire, d’une dette constituée d’indemnités accordées pour la réparation d’un préjudice corporel causé par une infraction, d’une dette d’un failli subsistant après la clôture ou même d’une dette d’amende pénale»;
- Une autre partie[4] estime que «l’interdiction [prévue à l’article 1675/13, § 3, du Code judiciaire] vaut pour le principal et les accessoires […] sans distinguer le principal, les frais et les intérêts, voire les autres accessoires» et que la doctrine contraire «ajoute une restriction supplémentaire au texte légal. En effet, le législateur ne parle pas d’une interdiction de remettre les dettes alimentaires en principal. L’interdiction est absolue, englobant dès lors tous les accessoires, en ce compris les frais et intérêts. Ceux-ci n’ont aucune autonomie et font intégralement partie de la dette alimentaire».
Le tribunal se rallie à cette dernière analyse. Il estime que «l’article 1675/13, § 3, du Code judiciaire, ne module pas l’interdiction d’une remise de dettes pour les dettes dites ‘incompressibles’ selon qu’il s’agit du principal ou des intérêts».
Le tribunal en conclut que l’ordonnance d’admissibilité n’a pas eu pour effet de suspendre les intérêts de la créance de Monsieur B et que le médiateur doit intégrer la déclaration de créance comprenant les intérêts post-admissibilité, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Pour lire la décision dans son intégralité, téléchargez le PDF
Tribunal du travail de Liège, division Dinant, 9e chambre, 19 décembre 2024 (RG 2023/00064/B)
Plan amiable – Contredit – Procès-verbal de carence – Vente de l’immeuble – Dignité humaine – Droit à un logement décent – Contredit abusif – Oui – Homologation du plan amiable.
La requérante est admise en règlement collectif de dettes en date du 28 avril 2023. Elle vit seule et est propriétaire de son logement en indivision. La mensualité du crédit hypothécaire de cet immeuble est intégrée dans son budget. Le créancier hypothécaire a donc été mis hors plan.
Le médiateur a proposé un projet de plan amiable. Un créancier a formé un contredit. Il estime que la vente de l’immeuble permettrait de dégager un disponible pour rembourser les créanciers.
Le tribunal rappelle qu’un contredit peut être considéré comme abusif lorsque:
- le refus n’est pas motivé et cause un préjudice important au débiteur et aux autres créanciers;
- le projet de plan amiable permettrait un remboursement des créanciers plus important qu’un plan judiciaire;
- le contredit va totalement à l’encontre de la nécessité de garantir au débiteur qu’il pourra mener une vie conforme à la dignité humaine et de rétablir sa situation financière[5].
Le tribunal estime que le contredit est abusif. La vente de l’immeuble causerait un important préjudice à la requérante. En effet, la requérante, de santé fragile, est parfois amenée à se déplacer en fauteuil roulant et son logement de plain-pied a été aménagé en conséquence. De plus, l’article 23 de la Constitution dispose que «chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. […] Ces droits comprennent notamment: […] 3° le droit à un logement décent».
Le tribunal homologue donc le plan amiable proposé par le médiateur.
Pour lire la décision dans son intégralité, téléchargez le PDF
Tribunal du travail de Liège, division Huy, 6e chambre, 10 janvier 2025 (RG 22/81/B)[6]
Plan amiable – Contredit – Procès-verbal de carence – Échec de la tentative de règlement amiable par le tribunal – Envoi du contredit par courrier recommandé – JustRestart – Recevabilité – Oui – Dénonciation du crédit irrévocable – Demande de trois offres de rachat de crédit hypothécaire.
Les requérants ont été admis en règlement collectif de dettes le 30 juin 2022. Ils sont propriétaires de leur immeuble financé en 2010 par un crédit hypothécaire de 30 ans pour un montant de 145.000 €.
La mensualité relative à ce crédit hypothécaire a été mise hors plan. Compte tenu de cet élément, le médiateur a établi le passif en principal à la somme de 53.734,42 € et a élaboré un projet de plan amiable qui prévoit un remboursement de 100%. Le créancier hypothécaire a formulé un contredit à l’égard de ce projet de plan.
Depuis l’admissibilité, le médiateur a versé les mensualités du crédit hypothécaire. Cependant, il n’a reçu aucun renseignement sur d’éventuels arriérés ante-admissibilité.
Or, le crédit a été dénoncé le 3 novembre 2021. Une tentative de conciliation a eu lieu devant le juge des saisies, mais a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation le 22 octobre 2021. À ce moment-là, les arriérés s’élevaient à 4.671,36 € et le capital à rembourser par anticipation à 107.924,41 €. Le 9 juin 2022, les médiés se sont vu signifier un commandement préalable à saisie sur leur immeuble.
Le tribunal a tenté de trouver une solution pragmatique et amiable. Il a proposé au créancier hypothécaire de reprendre le contrat de crédit si les arriérés sont apurés. Celui-ci refuse. Pour lui, la dénonciation est irrévocable. Il ne souhaite ni reprendre le crédit ni le racheter. Le créancier informe le tribunal que le montant des arriérés n’a pas été payé et qu’il s’élève à 5.923,64 € à la date du 5 octobre 2021.
Le tribunal analyse ensuite le formalisme du contredit. Il note, dans un premier temps, qu’il a été adressé au médiateur par courrier recommandé du 15 mai 2024. Or, l’article 1675/15bis nouveau du Code judiciaire prévoit que la communication doit se faire via la plateforme JustRestart, le créancier hypothécaire ayant par ailleurs accepté l’invitation à rejoindre le dossier dans la plateforme.
Le tribunal souligne que le médiateur a converti ce contredit sous format électronique et l’a enregistré sur JustRestart, estimant que la transparence prévalait. Le tribunal estime donc que le contredit est recevable.
Le créancier hypothécaire fonde ce contredit sur un arrêt de la Cour de cassation: «La résiliation unilatérale d’une convention entraînant irrévocablement l’extinction de celle-ci, la partie dont elle émane n’a aucun droit à y renoncer. L’absence de pareille renonciation ne peut, dès lors, constituer un abus de droit dans son chef. L’arrêt, qui, après avoir constaté que la demanderesse avait dénoncé l’ouverture de crédit qu’elle avait consentie au défendeur, considère que, quel que soit le caractère abusif ou non de cette dénonciation, la demanderesse a commis un abus de droit en maintenant sa décision de rompre ledit crédit[7].»
Selon l’enseignement constant de la Cour de cassation, «en vertu de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le principe consacré par le troisième alinéa de cette disposition, en vertu duquel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, interdit à une partie d’abuser d’un droit qui lui est reconnu par la convention. L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause»[8].
Le tribunal souligne que «la médiatrice a payé sans délai la mensualité hypothécaire dès après l’admissibilité, et tous ces paiements effectués depuis lors ont été acceptés par le créancier hypothécaire, tant dans sa partie ‘amortissement en capital’ que dans sa partie ‘intérêts’, ce qui ressemble dans les faits à une reprise d’exécution de bonne foi de la convention d’ouverture de crédit depuis juillet 2022 (article 1134 du Code civil), même si [le créancier hypothécaire] affirme recevoir ces paiements malgré lui et contre son gré…». Les intérêts conventionnels payés depuis l’admissibilité devraient donc être imputés sur le capital si on devait considérer la créance de S1 exigible en totalité.
Le tribunal, ayant la volonté de trouver une solution qui convienne à tous, invite les requérants à solliciter trois organismes de crédit hypothécaire afin d’envisager un rachat de crédit à un meilleur taux et de meilleures conditions. Si cette piste devait échouer, le tribunal entendra toutes les parties pour tenter une nouvelle conciliation afin de respecter les efforts considérables faits par les requérants depuis juillet 2022 pour payer leurs dettes.
Affaire à suivre…
Pour lire la décision dans son intégralité, téléchargez le PDF
Tribunal du travail de Liège, division Huy, 6e chambre, 20 janvier 2025 (RG 21/164/B)
- Plan amiable – Créance fiscale – Contredit – Contestation de la dette – Absence d’argumentation – Contredit fondé.
- Facture de l’agence immobilière – Nombreuses offres d’achat – Mauvaise collaboration des requérants – Dette de la masse –
- Dette nouvelle – Créancier hypothécaire – Augmentation du pécule de médiation – Rappel des principes de la procédure.
Les requérants ont été admis à la procédure en règlement collectif de dettes le 1er décembre 2021. Ils sont propriétaires de trois immeubles:
- leur maison d’habitation dont le crédit hypothécaire (non dénoncé) est toujours en cours;
- deux immeubles inoccupés mis en vente par une agence immobilière. La vente permettrait l’apurement total de l’endettement des requérants.
Le médiateur de dettes a dressé un projet de plan amiable prévoyant le paiement total des créanciers en principal et accessoires en un an et demi.
Le médiateur est donc contraint de déposer un procès-verbal de carence en date du 30 septembre 2022 en raison de plusieurs difficultés.
- Créance fiscale
La créance fiscale concerne la récupération d’allocations de chômage indues. La décision de la caisse de chômage n’a pas été contestée dans les délais. Le médiateur a prévu la consignation des fonds relatifs à cette créance contestée.
Le SPF Finances a formé un contredit: le requérant conteste le montant sans fournir aucun argument.
S’appuyant sur l’absence de recours à l’encontre de la décision de sanction, le tribunal ne peut que constater que le montant dû au SPF Finances est justifié. Le contredit est donc fondé.
- Frais de l’agence immobilière
L’agence immobilière a transmis au médiateur une facture d’un montant de 6.000 €, mais aucune vente n’a pu être concrétisée à ce jour.
Le tribunal rappelle que celle-ci avait été mandatée avant même l’admissibilité des requérants en règlement collectif de dettes, ce dont le tribunal a été informé tant dans la requête que par le médiateur désigné. Elle a reçu de nombreuses offres, mais reproche aux débiteurs leur comportement négligent, voire dilatoire. En effet, un des deux biens a fait l’objet d’une offre d’achat qui ne pourra aboutir que moyennant une expertise immobilière par la banque de l’amateur. À ce jour, il semblerait que les requérants y fassent obstacle.
Au regard du travail important réalisé par l’agence depuis plusieurs années, le tribunal considère leur créance comme dette de la masse. Le paiement sera effectué au moyen des fonds se trouvant actuellement sur le compte de médiation. Le tribunal rappelle également aux requérants qu’à défaut de bonne collaboration de leur part dans la vente de leurs immeubles, une fin de procédure, voire une révocation, pourrait être envisagée.
- Dette nouvelle
Le créancier hypothécaire a informé le médiateur de l’augmentation de la mensualité de 134 €. Cette augmentation est restée impayée, créant ainsi une dette nouvelle.
Le créancier hypothécaire invoque:
- l’augmentation de la mensualité du crédit hypothécaire due à une hausse du taux d’intérêt;
- l’absence de réaction des requérants aux appels, SMS ou mails les informant de l’augmentation de la mensualité créant ainsi une dette nouvelle actualisée à 819,13 €;
- le paiement tardif des mensualités.
Le tribunal décide d’augmenter le pécule de méditation et de payer la dette nouvelle à charge du compte de médiation. Il rappelle également aux requérants que la date d’échéance pour le paiement de la mensualité est fixée au sixième jour du mois. À défaut de recevoir les versements à temps, le crédit pourrait être dénoncé, ce qui démontrerait, une fois de plus, un manque de collaboration de leur part.
Pour lire la décision dans son intégralité, téléchargez le PDF
Tribunal du travail de Liège, division Dinant, 9e chambre, 16 janvier 2025 (RG 2023/00154/B)
Révocation – Manque de collaboration – Diminution fautive du passif – Fausses déclarations.
Le requérant a été admis en règlement collectif de dettes le 13 octobre 2023. Dans sa requête, ce dernier mentionne être propriétaire d’un véhicule de marque Mercedes.
Le tribunal est saisi d’une demande de révocation de la part du médiateur. Après avoir rappelé les causes d’une révocation[9], le tribunal souligne que la révocation n’est pas automatique et que le juge apprécie souverainement si le manquement est suffisamment grave pour entraîner la révocation. Selon la cour du travail de Mons[10], «[…] la révocation n’est pas automatique: le juge doit apprécier à leur juste valeur l’importance et le caractère inexcusable des manquements visés aux points 1°, 2°, 3° et 5°, étant entendu que les faits visés sont des faits graves et inadmissibles (doc. Ch. repr., 1073/11 – 96/97, p. 92 et 93). Dans le cadre de son appréciation, le juge peut se référer à la notion de bonne foi procédurale: le débiteur reste tenu par sa bonne foi procédurale; ce qui implique, d’une part, une transparence totale concernant sa situation dans sa globalité et, d’autre part, une collaboration loyale et active au bon déroulement de la procédure en règlement collectif de dettes. Toutefois, cette notion n’a pas d’existence autonome, de manière telle que l’absence de bonne foi procédurale ne peut justifier à elle seule la révocation: il faut démontrer que le débiteur a commis l’un ou l’autre des faits visés à l’article 1675/15, § 1er, du Code judiciaire […]»
Le tribunal analyse les faits et relève qu’en février 2024, le médiateur est contacté par un créancier nouveau, Madame B. Il lui explique que le requérant, propriétaire d’une Dacia Duster, lui a demandé de reprendre à son nom l’assurance et l’immatriculation du véhicule afin d’éviter qu’il ne tombe sous le coup de la procédure en règlement collectif de dettes et ainsi éviter la vente du véhicule. Selon leur arrangement informel, le requérant devait lui rembourser les frais d’assurance, d’immatriculation et de contrôle technique. Le requérant n’ayant pas respecté ses engagements, Madame B a résilié la police d’assurance et radié l’immatriculation, forçant ainsi le requérant à trouver d’autres solutions.
Le requérant affirme qu’il aurait donné le véhicule Dacia à titre gratuit, mais qu’il l’a récupéré en raison de différends avec Madame B. Il l’a ensuite à nouveau «donné» à titre gratuit à une autre personne. En agissant de la sorte, il prive une seconde fois ses créanciers du bénéfice éventuel de la vente de ce véhicule.
Le tribunal révoque l’admissibilité du requérant. Celui-ci «a fautivement diminué son actif, en faisant sortir de son patrimoine un élément d’actif pouvant potentiellement servir à désintéresser ses créanciers. Pareil manquement justifie la révocation de la décision d’admissibilité au règlement collectif de dettes».
Pour lire la décision dans son intégralité, téléchargez le PDF
Virginie Sautier,
juriste à l’Observatoire du crédit et de l’endettement
[1] Article 1675/7, § 1er du Code judiciaire.
[2] Article 1675/13, § 3 du Code judiciaire.
[3] C. André, «Les plans de règlement judiciaire», in Le fil d’Ariane du règlement collectif de dettes (C. Bedoret coord.), Limal, Anthemis, 2015, p. 333 et s.
[4] F. Burniaux, «Les dettes incompressibles» in Le créancier face au règlement collectif de dettes: la chute d’Icare?, Anthemis, 2017, p. 168. L’auteur renvoie à C. Bedoret, J.-C. Burniaux et M. Westrade, «Inédits de règlement collectif de dettes III», JLMB, 2015, p. 742-743.
[5] C. trav. Mons (10e ch.), 20 octobre 2015, RG 2015/AM/175, JLMB, 16/355. Le tribunal souligne.
[6] Réouverture des débats prévue en avril 2025. Nous ne manquerons pas de vous informer des suites dans un prochain numéro.
[7] Cass. 3/12/2007, RDC 2008/3 – mars 2008, p. 288-289.
[8] Voir notamment, Cass., 9 mars 2009, RG C.08.0331.F, Pas., 2009, n° 182; Cass., 12 décembre 2005, RG S.05.0035.F, Pas., 2005, n° 664.
[9] Article 1675/15 du Code judiciaire.
[10] C. trav. Mons, 15 mars 2016, inédit, RG 2015/AM/388.